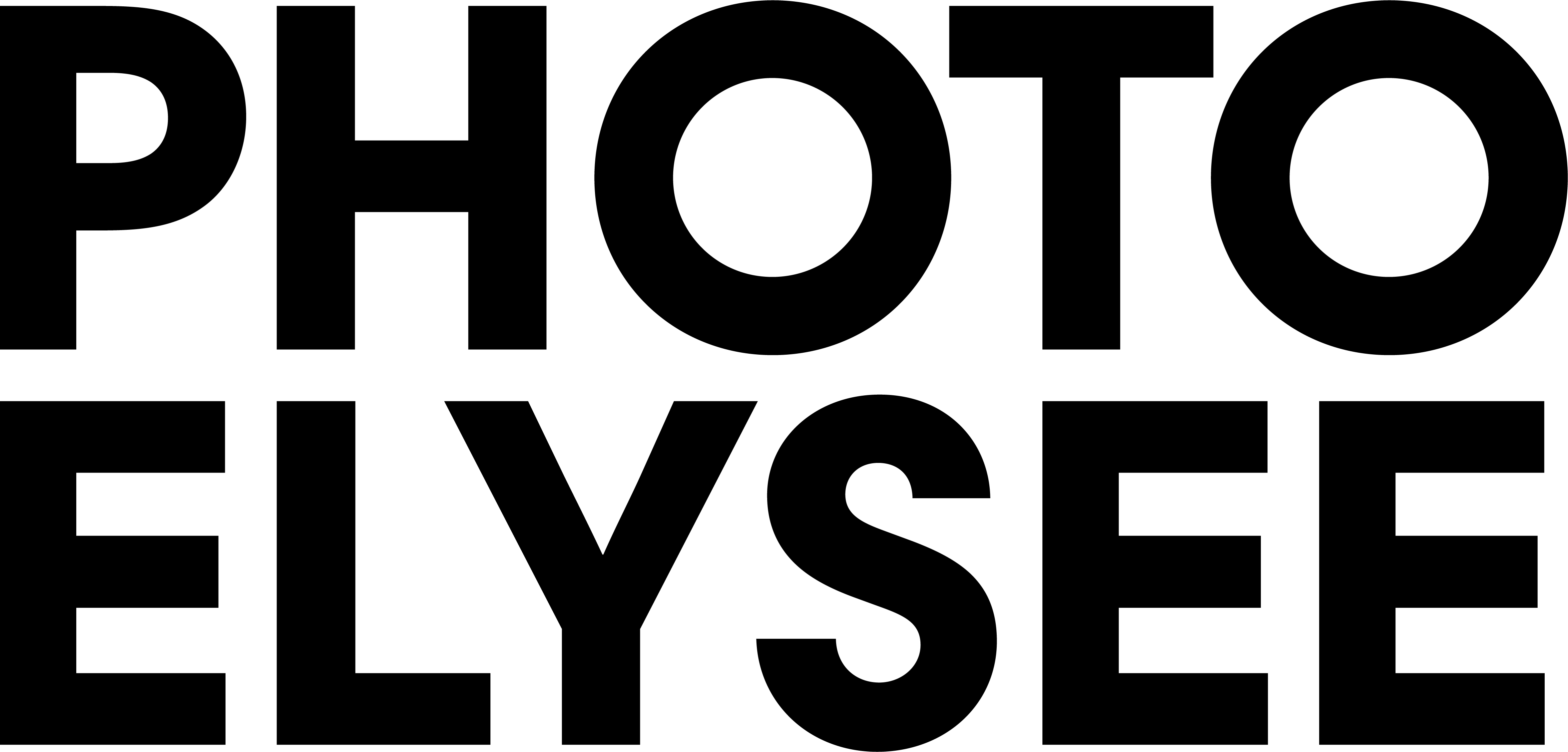Il y a ceux dont la voie est tracée depuis l’enfance, droite, imperturbable. Il y en a d’autres aux vocations plus tardives, aux errements qui n’en sont pas vraiment et qui prennent tout leur sens un peu plus tard. Matthieu Gafsou appartient plutôt à cette seconde catégorie. Pas de lointains souvenirs d’enfance avec l’argentique de papa ou maman entre les mains. Plutôt une passion post-adolescente, survenue comme un caprice ou une lubie mais qui a pris racine.
Acheter un appareil, comme un premier pas. Puis ne jamais le lâcher. «Nulla dies sine linea» («pas de jour sans une seule ligne») disaient certains, d’Apelle à Emile Zola. Pas un jour sans un cliché semble être la devise de Matthieu Gafsou. C’est d’ailleurs par la répétition qu’il va petit à petit apprivoiser la machine qu’il a entre les mains.
Mieux vaut tard que jamais
Poser des bases techniques pour débuter, la théorie viendra plus tard. Une idylle romantique se crée petit à petit, comme il qualifie lui-même sa relation avec la photographie. Entre deux cours de cinéma et de philosophie à l’Université de Lausanne (UNIL), Matthieu Gafsou parcourt la ville caméra au point. Il saute les barrières, s’aventure dans les recoins cachés de Lausanne, enhardit par ce nouvel amour. «Je suis de nature plutôt timide, avoue-t-il. Mon appareil photo me protégeait du monde, comme une sorte de filtre qui me permettait de partir à l’aventure et de découvrir des espaces que je n’aurais peut-être jamais visités sans.»

A la fin de son master, il décide de s’inscrire en photo au Centre d’enseignement professionnel de Vevey, non sans péripéties. Il n’aurait même jamais dû y entrer, de son propre aveu: «Je n’avais pas de CFC – un prérequis – et j’ai fait ma demande d’inscription sur un coup de tête deux mois après les délais, un soir où je travaillais encore au journal 24Heures comme secrétaire de rédaction. J’ai finalement dû écrire au canton pour qu’ils acceptent ma candidature», se souvient-il, le sourire de la nostalgie aux lèvres. Il gardera certains stigmates de ce choix de carrière tardif. Un sentiment d’imposture, parfois, lui qui n’a pas autant d’expérience en utilisation de flashs ou en studio que certains de ses camarades, pour la plupart ses cadets. Un petit nouveau parmi les petits nouveaux. Difficile à croire en l’écoutant parler dans son studio pulliéran et en connaissant sa carrière. Un CV aujourd’hui long comme le bras derrière lequel se cache pourtant une étonnante candeur.
La photographie pour chasser ses angoisses
Une impression de ne pas être à la hauteur? C’est plus complexe, plus profond qu’un vulgaire sentiment de comparaison aux travaux ou aux attentes des autres. Plutôt une lucidité rétrospective sur sa pratique, qui n’a jamais tenté d’être ce qu’elle n’était pas. Des images à son image, tout simplement. Et une pratique qui se complexifie à mesure que l’homme évolue: «Quand je regarde Surfaces, ma première série, je vois une approche très «contrôlée», des photos d’architecture, de face. Petit à petit, j’ai réussi à déconstruire une partie de ma personnalité, à faire face à mes angoisses par rapport au monde, par rapport aux gens.»
A des années-lumière de l’artiste ivre de ses propres théories, plus habile en réseautant un verre à la main qu’en colorimétrie ou en temps de pause. Dans sa bouche, «vernissage» rime plus avec enfer qu’avec consécration. Il a pourtant dû s’y astreindre rapidement, à ces obligations sociales, presque mondaines. A moins de 30 ans, il reçoit le prix de la fondation HSBC et participe à la deuxième édition de ReGeneration en 2010. Une première collaboration avec le Musée de l’Elysée. Mais l’un de ses premiers souvenirs vivaces de l’institution remonte à plus loin, à 2005 pour être précis, lors la toute première édition de cet événement mettant en lumière la relève du huitième art: «Ça m’a marqué, car je me souviens m’être dit que je n’avais pas le niveau. Ça m’a motivé et déprimé à la fois, même si j’étais évidemment encore en phase d’apprentissage, et que je le suis encore.» Candeur toujours.

ReGeneration 2, c’est aussi l’occasion de se constituer un important réseau et de commencer à tisser des liens avec l’Elysée. A 33 ans – «l’âge du Christ», il a le 18 avenue de l’Elysée pour lui tout seul. Only God Can Judge Me: un travail sur la drogue, ses consommateurs et cette Lausanne que le passant évite ou préfère ne pas voir. Véritable adoubement par la profession, mais lui préfère tempérer: «C’est un grand moment dans ma carrière. Ça l’aurait été pour n’importe quel photographe évidemment, car l’Elysée reste un monstre sacré dans le milieu. Après, en tant qu’enfant du pays, il est peut-être moins prestigieux d’y avoir l’honneur des cimaises.» Il retient aussi de cette exposition la confiance d’Anne Lacoste, la conservatrice de l’époque. Only God Can Judge Me est un travail lourd, engagé, qui n’a pas forcément fait consensus. Un choix curatorial courageux pour un projet qui n’aurait peut-être pas eu autant d’écho sans le coup de pouce du musée. Et en échange, l’aura de l’Elysée le suit depuis comme une ombre bienveillante.
Fini la candeur
Aujourd’hui, Matthieu Gafsou fait presque partie des meubles. Certaines de ses images trônent désormais dans les collections de l’institution. Il a aussi participé à sa manière au déménagement à Plateforme 10, troquant sa casquette d’artiste contre celle de photographe de commandes: «Documenter et voir sortir de terre un tel lieu était très enthousiasmant, affirme-t-il. C’est aussi une autre façon de travailler, presque plus confortable. On est au service d’un client, on suit des indications et on a des délais serrés. Moi qui mets en général quatre années pour terminer une série, cela me permet de changer de rythme. Par contre, il faut savoir mettre son ego d’artiste de côté, ce qui ne m’a jamais posé problème.»
Sur les hauts de Pully, Matthieu Gafsou contemple avec une douce bienveillance son parcours. Il n’est pas du genre à avoir des regrets, encore moins des remords. Des occasions manquées, il n’y en a de toute façon pas eu tellement. «Moins de timidité lors de mes premiers vernissages peut-être?» Passer à côté d’une carte de visite ou d’une poignée de main, rien de bien grave en somme. La carrière de Matthieu Gafsou, c’est surtout la lente métamorphose d’un homme, que l’on discerne en filigrane de ses travaux successifs. La quête des origines (Surfaces), le rapport à l’altérité (Only God Can Judge Me) ou encore le besoin d’apaisement (Ether). Utiliser sa caméra comme remède contre ses peurs et ses failles. Vivants viendra peut-être parachever le besoin de se confronter à ses propres angoisses: «J’ai longtemps adopté une posture nihiliste face à l’écologie, thème central de ce prochain projet. Mais clamer haut et fort «après moi le déluge», cela ne tient plus lorsque l’on a des enfants.» Il y a un monde entre le photographe maraudeur pétri d’incertitudes et l’homme apaisé qu’il est devenu. Fini aussi la candeur de sa jeunesse. «Il était temps», souffle-t-il. Mais reste la sincérité. Dans ses paroles, dans son travail, dans son regard. Comme si chaque cliché était toujours un moyen d’apprendre. Ou simplement le début d’une histoire.