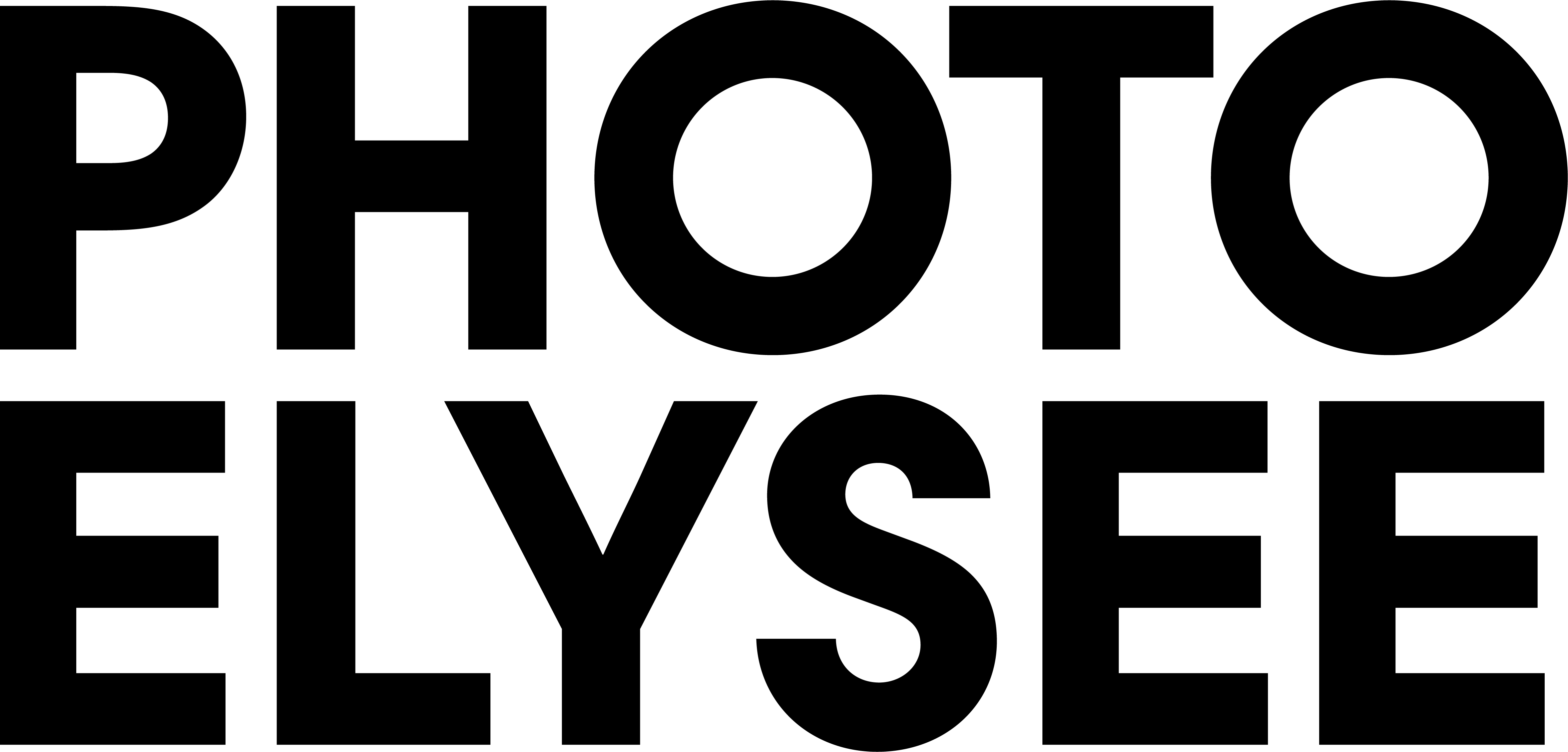Récemment arrivée à la régie des œuvres pour les expositions de Photo Elysée, Marina Martin a le sourire facile et le regard pétillant. Quelque chose de rond et de feutré se dégage de ses manières, tandis qu’elle nous invite à la suivre jusqu’à une table vide dans le café du musée. On a tout de suite envie de la tutoyer, malgré l’usage et l’étiquette. «Je suis très informelle», déclare-t-elle en nous entendant glisser gauchement d’un pronom à l’autre. «J’aime bien tutoyer les gens, lorsque ça ne les dérange pas, et qu’on me tutoie en retour.»
On devine un passé d’élève studieuse et une logisticienne aguerrie dans la feuille de notes qu’elle déplie soigneusement devant elle. «Je ne veux pas risquer d’oublier quelque chose d’important.» Son discours, parfaitement structuré, témoigne de sa formation d’architecte, et son accent ensoleillé de son parcours à la mobilité extraordinaire. Espagnole et brésilienne d’origine, Marina Martin a grandi avec un pied dans chaque pays jusqu’à l’obtention de son diplôme d’architecte. Par la suite, un master en gestion du patrimoine culturel à Paris, Evora et Padoue, avant que son doctorat en histoire et en histoire de l’art ne la ramène respectivement vers sa terre natale brésilienne et à Venise. Parmi les six langues qu’elle parle couramment, nous nous découvrons un deuxième idiome commun et quittons bientôt le français dans un éclat de rire, pour poursuivre l’entretien en portugais…
La curiosité comme moteur d’une passion
Le fil rouge de son parcours, confie-t-elle, réside dans l’amour des musées et de l’histoire humaine qu’ils contiennent. Une passion née suite à une visite du Musée Reina Sofia de Madrid, où sa mère l’avait emmenée enfant. Une œuvre exposée donnait à voir deux vidéos en miroir, l’une présentait une naissance, l’autre capturait les derniers sursauts d’une agonie. «L’art a pour vocation de toucher, quitte à ébranler. Je crois que mon attrait pour l’univers muséal vient de là. Il peut s’expliquer par une quête du bouleversement.»
Et la photographie? «J’ai eu l’occasion de me familiariser avec la photo dans le poste que j’occupais précédemment, au sein d’une grande collection privée à Zurich. Maintenant je suis en train de me perfectionner dans la complexité des techniques photographiques et c’est précisément ce qui m’a attirée dans ce poste. J’aime les terres inconnues, les pans de savoir inexplorés. Je suis une incorrigible curieuse.»
La régie des œuvres, ce métier de l’ombre
Si plusieurs services de l’institution présentent une certaine familiarité pour le grand public, comme la scénographie, l’édition ou la médiation, d’autres demeurent beaucoup plus hermétiques. Lorsqu’on lui avoue que nous n’avons qu’une très vague idée de ce qu’est la régie des œuvres muséales, Marina Martin s’en amuse: «C’est bien normal, il s’agit d’un métier de l’ombre. Moi-même, je faisais entre autres le travail d’une régisseuse à Zurich, sans connaître ce titre.»

La régie se définit comme la gestion des œuvres que l’on emprunte et que l’on prête à des institutions partenaires. En d’autres termes, le service est responsable du mouvement des œuvres, de l’établissement du contrat de prêt jusqu’à l’accrochage de l’œuvre une fois arrivée à destination. La régie des expositions, pôle où évolue Marina Martin, est chargée de l’emprunt; à ce titre, elle s’occupe de l’acheminement des œuvres étrangères vers Photo Elysée dans le cadre des expositions temporaires, puis de la reddition de ces mêmes œuvres à leurs institutions-mères, une fois l’exposition terminée. Elle complète la régie des collections, pôle responsable du prêt des œuvres de Photo Elysée aux musées étrangers qui en font la demande.
Les trois aspects d’une activité exigeante
Le métier de régisseuse, explique Marina Martin, comprend trois axes principaux de travail. Le premier concerne l’aspect contractuel: chaque prêt donne lieu à un contrat établi entre l’institution partenaire et Photo Elysée. Y figurent notamment les conditions de transport, de déballage et d’accrochage. «Il arrive que des convoyeurs voyagent avec l’œuvre. Il s’agit en quelque sorte d’ambassadeurs de l’institution partenaire, qui s’assurent que l’œuvre soit transportée, entreposée et exposée conformément aux conditions stipulées dans le contrat.» Le second comprend la logistique, part non-négligeable du métier. L’organisation du transport, de l’emballage et de l’accrochage des œuvres occupe aisément des journées entières, sans oublier les contrats d’assurance à passer au peigne fin.
Enfin, la partie ayant trait à la conservation préventive exige une attention très aiguisée. La température, l’humidité, la luminosité sont autant d’éléments sur lesquels la régisseuse doit garder une veille constante, qui se traduit par des rondes fréquentes dans l’espace d’exposition. Si le plexiglas protège efficacement les œuvres contre les dommages les plus redoutés – vandalisme, ou simple négligence de la part d’un public trop curieux –, il s’agit malgré tout de surveiller fréquemment l’espace au cas où les photographies, support réputé exceptionnellement fragile, toléreraient mal certaines conditions d’exposition. «Il faut avoir des yeux de lynx pour exercer correctement ce métier, couplés à une expérience du comportement typique d’une photographie, sourit Marina Martin. Je dois être à l’affût du moindre signe de changement, par exemple, qui indiquerait qu’une photographie réagit mal aux conditions climatiques.»
Des prêts passés au crible
L’étape du déballage constitue un rituel où le regard d’expert est particulièrement sollicité. Vient s’ajouter un respect strict du protocole de manipulation: «Interdiction formelle de toucher une œuvre à mains nues! Des gants spéciaux sont exigés, pour le moindre contact avec un tableau, sculpture ou photographie.» Nous quittons notre coin de table pour suivre Marina Martin à travers un couloir, qui débouche sur une petite pièce baignant dans une lumière blanche, équipée d’un chevalet et d’appareils rappelant des microscopes de laboratoire. «A chaque fois qu’une œuvre est déballée, je l’installe sur mon chevalet et je l’examine sous la loupe, dans cette chambre prévue à cet effet. Je traque les moindres imperfections et je les consigne dans un constat d’état destiné à l’institution d’où provient l’œuvre.»
Il faut donc en écrire beaucoup? «Deux pour chaque œuvre! Un lors de la réception, un autre au moment de l’envoi. Et ça, c’est uniquement de notre côté. L’institution partenaire fait de même: un seul prêt donne donc lieu à quatre rapports»
La régie par temps de crise
Outre le mouvement habituel des œuvres, qui vont et viennent au gré des échanges entre musées, Marina Martin se doit également d’être parfaitement formée au plan de sauvetage des objets d’art en cas d’alerte rouge: incendie, séisme, inondation ou encore menace nucléaire. «C’est une perspective angoissante, bien sûr, mais il faut y être préparé pour pouvoir réagir très rapidement en cas de nécessité.» Avant chaque exposition, la régie reçoit une liste exhaustive des œuvres à sauver en priorité, qui devront faire l’objet d’une évacuation par les pompiers, par opposition aux autres œuvres qui devront être mises à l’abri «in loco» et placées dans un espace aménagé à cet effet au sein même du musée.
Comment détermine-t-on le degré d’importance d’une œuvre? «C’est une question difficile et douloureuse! Toutes les œuvres sont importantes, dans le sens où elles portent chacune un fragment d’histoire humaine. La valeur marchande constitue bien sûr un critère, mais on évalue également la notoriété du photographe, son importance dans le paysage artistique, la valeur symbolique de l’œuvre, sa signification au sein d’un mouvement…»
Polyvalences et itinérances
Arrivée à la régie au gré des méandres de son parcours, Marina Martin n’envisage pas pour l’instant de s’orienter vers d’autres services de l’institution muséale. La conjonction des compétences exigées représente un défi qu’elle apprécie de relever au quotidien: «Mon travail en appelle à un savoir-faire technique, que j’ai d’ailleurs adoré m’approprier, mais il présente en outre l’extraordinaire avantage de solliciter l’entièreté de mon bagage académique. Mes connaissances d’histoire de l’art me sont utiles tous les jours. Ma maîtrise de l’espace et mon sens de la méthodologie sont des atouts qui me viennent directement de mes années d’architecture.» Sans parler de son impressionnant multilinguisme, très apprécié des nombreuses institutions avec lesquelles Marina Martin est amenée à communiquer.
Une anecdote fleurit sur ses lèvres, amenée peut-être par la chaleur du portugais. Si la Suisse l’a initialement attirée par l’abondance de langues qu’on y parle, son arrivée en sol helvétique s’est soldée par une légère déception sur ce plan: «J’imaginais naïvement que tout le monde en Suisse parlait couramment les trois langues nationales. J’ai vite constaté à quel point c’est loin d’être le cas! Les territoires linguistiques sont très distincts, ils ont chacun leur culture propre et chacun leurs excentricités.» Les Romands bons vivants et les Alémaniques réservés, un cliché? «Pas du tout! Je partage ma vie entre Lausanne et Zurich et rien n’est plus vrai, je le constate tous les jours!» On glisse une remarque sur sa vie de nomade, qui semble bien convenir à cette voyageuse érudite et à sa soif inextinguible de nouveaux horizons. Le mouvement, encore et toujours? Celui des œuvres régies par ses soins, voyageant de musée en musée, qui reflètent sa propre trajectoire, écumant les centres culturels à la recherche de nouveaux savoirs à acquérir?
Son visage s’éclaire, elle sourit de cette corrélation inattendue: «E isso mesmo.» Ce qui veut dire: «C’est exactement ça.»