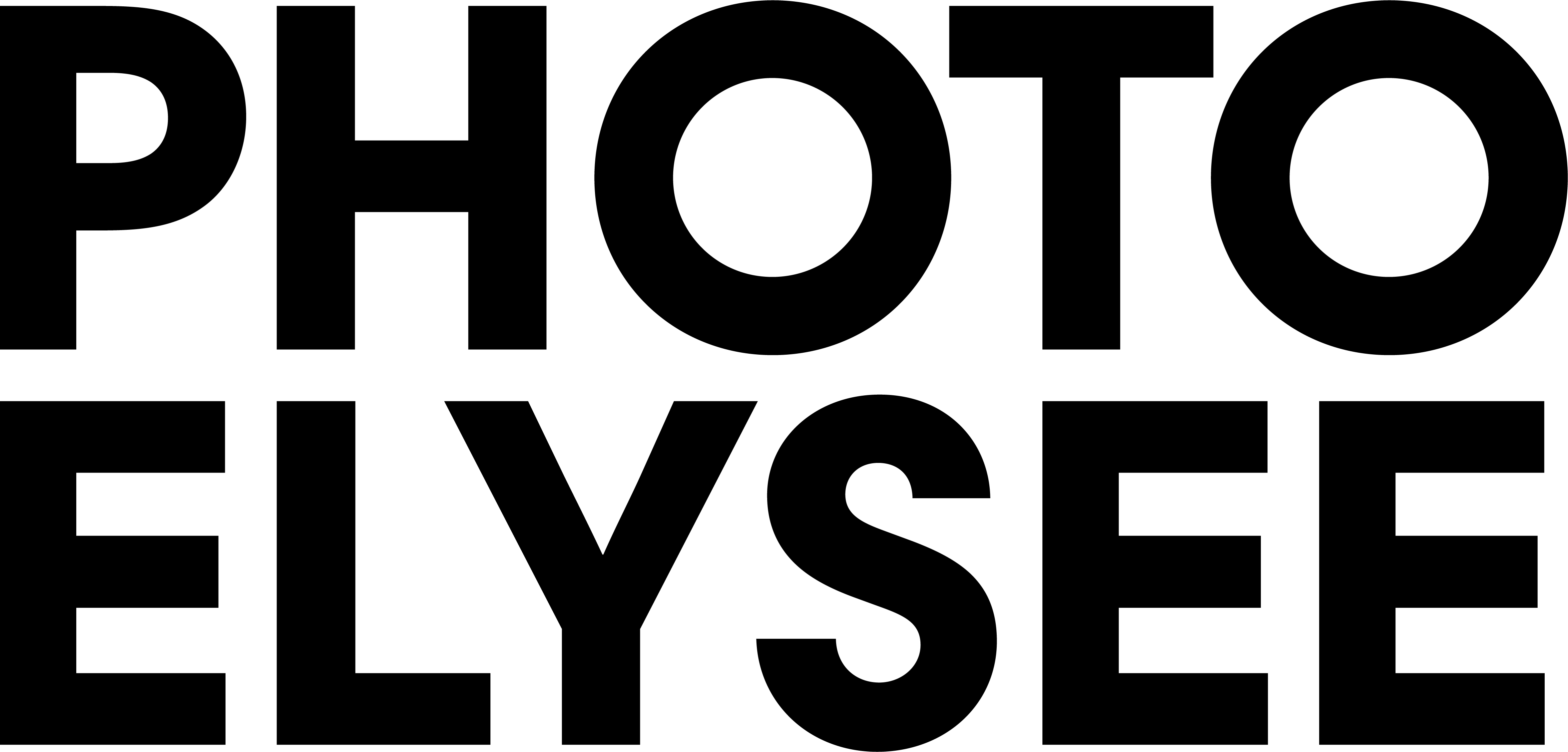Lorsqu’on évoque avec Valérie Belin l’importance d’un regard extérieur sur le travail d’un artiste, d’un regard qui invite à la remise en question et aux choix éclairés, la photographe et plasticienne française admet volontiers que c’est celui qu’a porté Photo Elysée sur son parcours qui a compté. C’était en 2008-2009, lorsque le musée lausannois organisait une rétrospective de son œuvre qui se présentait sous forme de séries photographique. Auparavant, William A. Ewing, ancien directeur de l’institution, avait sollicité Valérie Belin, dont il loue la «vision unique» et «sa façon de perpétuellement se réinventer », pour plusieurs ouvrages et expositions collectives.
Depuis plus dix ans, cette relation privilégiée est ponctuée d’allers-retours entre Paris et Lausanne, entre conférences, rencontres et expositions. «Photo Elysée n’a pas été un one-shot, comme c’est souvent le cas, explique depuis son appartement parisien Valérie Belin. Il y a une vraie continuité dans le temps. C’est très stimulant pour une artiste que l’intérêt persiste, d’être encouragée dans notre évolution. De constater ainsi que les thématiques traitées résonnent toujours.» Le musée représente pour la Française un point d’ancrage en Suisse, pays dont elle souligne la tradition photographique très présente.
Des rencontres marquantes
A ses débuts, une telle confiance était plutôt rare. Parce qu’elle était jeune, sans doute, mais aussi femme, très certainement. Valérie Belin se souvient d’un photographe et professeur des Beaux-Arts de Versailles, où elle s’inscrit en suivant son intuition, qui confiait à ses élèves un appareil photo pendant une semaine. L’étudiante, qui tenait alors pour la première fois entre les mains un appareil autre que l’Instamatic familial, capture sa ville, l’asphalte, l’éclairage solaire. Un résultat auquel ne s’attend visiblement pas son enseignant, qui s’exclame à la vue des clichés que «ce ne sont pas des photos de femmes…»
Un compliment déguisé venant de la bouche de cet homme, mais qui sonne comme une provocation aux oreilles de la jeune femme. Elle choisit de continuer dans cette voie, sans toutefois le conscientiser sur le moment, «pour lui prouver le contraire». D’autres rencontres seront déterminantes au cours de ses cinq ans d’études. L’une la marque plus que les autres: celle avec son professeur d’histoire de l’art, qui lui transmet sa passion pour l’art minimal américain («silencieux, basé sur l’effet de présence») et son exact opposé, l’art baroque italien, dont l’effet théâtral sert à la propagande. Une dualité omniprésente dans le travail de la photographe.
Travail d’appropriation
Si Valérie Belin choisit à ses débuts une photographie non narrative, sa recherche d’objets transitoires, métaphoriques, la rapproche peu à peu de l’humain, jusqu’à sa série sur les bodybuilders en 1999, puis celles des sosies de Michael Jackson et des personnes transgenres. Avec, depuis lors, une constante: «Lorsque je photographie des personnes vivantes, ces dernières revêtent un aspect décoratif, comme désincarné» détaille l’artiste d’une voix posée, habituée à parler de sa passion, qu’elle aime décrire comme relevant davantage d’un «travail d’appropriation que d’un travail purement photographique». Avant-gardiste, Valérie Belin utilise depuis 2000 les outils de post-production numériques. Aujourd’hui, ce sont les jeunes mannequins qui ont ses faveurs. «Elles sont des muses pour moi. Elles représentent les réceptacles de toutes les dimensions fantasmatiques de l’époque qui est la nôtre.»
Un équilibre précaire
Valérie Belin aime aussi se jouer des stéréotypes, qui traversent et se transforment au gré des époques, et de leur pouvoir destructeur. «On a parfois la sensation de ne pas reconnaitre ce que l’on voit dans mes photographies, un trouble s’installe», analyse-t-elle. « C’est là que l’exercice de déconstruction du stéréotype s’opère. Un phénomène qui nous ramène à l’équilibre du vivant. On pourrait le qualifier de parfaite imperfection. Mon travail contient toujours une constante de deux entités très antagoniques, la mort et la vie, l’organique et le virtuel.» Un équilibre avec lequel composent les artistes, constamment au bord du précipice, et encore plus, on le comprend aisément, en ces temps incertains. Plusieurs fois primée au cours de sa carrière, notamment lauréate du Prix Pictet en 2015, la photographe française reconnaît le doute qui s’installe à chaque nouveau projet, l’impression de «recommencer à zéro, « de ne plus rien savoir». Mais qu’importe les récompenses, qu’importe la reconnaissance. «Rien de nous oblige à faire ce qu’on fait, il n’y a aucune nécessité de l’art», constate Valérie Belin, rappelant au passage la fragilité de ce statut. «On est confronté comme tout le monde à la dureté de la vie, des relations sociales et professionnelles. Il faut arriver à se protéger pour se défendre mais garder sa sensibilité, sa fragilité, sa perméabilité.» Et se tourner vers un autre métier quand l’abîme se rapproche trop? «Non, je serais incapable de faire autre chose.»
Si son imaginaire a été entravé par la pandémie de façon «pernicieuse», sa quête de l’être humain dans toute sa complexité reste une source d’inspiration intarissable, dans son métier comme sa vie personnelle: «Mon travail peut sembler froid dans sa facture, mais j’entretiens un rapport emphatique avec mes sujets et l’humain me fascine.» Directeur de Photo Elysée de 1996 à 2010, William A. Ewing abonde, soulignant le «plaisir de travailler avec une artiste, curieuse, honnête avec elle-même et ouverte au monde, qui n’a pas fini de nous surprendre». Valérie Belin, elle, se languit de retrouver cette «impulsion naturelle» à sortir, aller vers les autres, retourner au théâtre, au musée, toutes ces choses qui ont été brutalement évacuées de nos quotidiens. «C’est maintenant qu’il faut être solidaire et ne pas baisser les bras.»